« Jacobins », « jacobinisme… » sans oublier les Girondins : voilà des clichés qui traînent partout dans la presse , le monde politique et le monde associatif, dès qu’il est question de centralisme, ou de statut des langues régionales. Mas ceux qui utilisent ces termes, plus ou moins à tort et à travers, savent-ils de quoi on parle au juste ? Un retour à l’histoire ne peut pas faire de mal.
Une question historique traitée par Robert Lafont
On ne lira et relira jamais assez Robert Lafont, et le centenaire de sa naissance fournit l’occasion rêvée de redécouvrir certains de ses enseignements, propres à nourrir la réflexion de ceux qui aujourd’hui réfléchissent aussi bien à la question des langues dites régionales qu’à celle de la démocratie en France – les deux questions étant d’ailleurs liées. Ceux-là tireront notamment profit de la lecture de deux ouvrages particulièrement instructifs malgré leur âge déjà vénérable : La Révolution régionaliste (1967) et Sur la France (1968). Entre autres sujets de réflexion, on trouvera là des analyses de nature historique sur le concept de nation, sur le centralisme, et sur le jacobinisme, ces deux derniers termes étant pour Lafont trop souvent associés. Ce sont ces analyses qui constituent le point de départ des quelques remarques qui suivent.
Sur la France : une réflexion historique sur la question de la nation
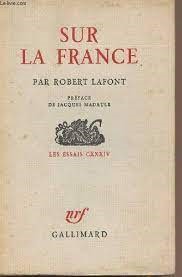 Sur la question de la nation – la nation française en l’occurrence –, Sur la France propose une théorie qui s’appuie, au départ, sur celle, bien connue, développée dans un discours célèbre d’Ernest Renan en 1882, volontiers cité dans les débats actuels par des gens qui d’ailleurs ne l’ont pas forcément lu et compris.
Sur la question de la nation – la nation française en l’occurrence –, Sur la France propose une théorie qui s’appuie, au départ, sur celle, bien connue, développée dans un discours célèbre d’Ernest Renan en 1882, volontiers cité dans les débats actuels par des gens qui d’ailleurs ne l’ont pas forcément lu et compris.
Lafont en rappelle les principes essentiels : ce qui fonde la nation, ce n’est pas l’ethnie, la religion, ou la langue, mais l’adhésion (un « plébiscite de tous les jours ») à un projet commun, (dont Renan, fraîchement rallié à la République, se garde bien au demeurant de définir trop précisément les contours).
À partir de là, Lafont revisite l’ensemble du parcours de la construction de la France telle que nous la connaissons.
Avant la Révolution : la construction de la monarchie absolue
Sur son territoire actuel, dont les frontières sont atteintes progressivement entre le XIIIe et la période contemporaine, cohabitent au départ des groupes humains, ceux que Lafont appelle les nations primaires, dotés de caractères linguistiques et culturels spécifiques[1], et ayant connu, de façon plus ou moins claire, l’ébauche d’un processus de construction étatique, processus stoppé par l’inclusion dans le domaine royal capétien. Ce domaine royal étant constitué au départ par le cœur du Bassin Parisien autour de la future capitale.
L’histoire du royaume de France est donc celle de l’imposition progressive d’un modèle politique, linguistique et culturel spécifique, celui du noyau initial, aux dépens de ce qui constituait la spécificité des nations primaires, dont les langues, notamment, se voient réduites à un statut subalterne, tandis que les quelques contre-pouvoirs résiduels (institutions provinciales et urbaines) sont progressivement vidés de toute substance, au cours d’un processus de centralisation accéléré par les progrès de la monarchie absolue.
La Révolution met fin à cette monarchie, et fait du Peuple le nouveau souverain.
Et les populations concernées sont parties prenantes du nouvel ordre des choses, à travers le mouvement fédératif qui rassemble les citoyens des anciennes provinces dans un pacte d’adhésion à une nouvelle collectivité politique, la Nation, incarnation d’une action révolutionnaire qui ne se fonde plus sur la fidélité à la dynastie, mais sur la promotion de nouvelles valeurs, celles de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, et l’établissement d’un système politique démocratique. Des valeurs et un système qui ne sont pas liées à un territoire, celui du Royaume tel que la Révolution en hérite, mais à la dynamique d’un projet valable pour tous les hommes, où qu’ils soient.
C’est en ce sens que la Révolution est, au départ, universaliste. C’est ce que Lafont appelle la Nation secondaire, dépassement dialectique et en acte de la subordination des diverses nations primaires du Royaume à une seule.
Renan s’arrêtait là, considérant que du même coup les composantes du nouvel ensemble renonçaient à leurs spécificités et à leurs mémoires historiques propres : il suggérait explicitement l’oubli aussi bien de la croisade albigeoise que de la Saint Barthélémy, deux évènements promus par lui à la dignité de cadavres dans le placard qui devaient y être définitivement enfermés. Et, dans sa logique, si les langues locales avaient leur place dans le souvenir des individus qui les avaient pratiquées dans leur enfance, c’est clairement le français qui était le mieux armé pour dire le monde nouveau et l’avenir.
Ce que Lafont propose, c’est de tirer tous les enseignements des intuitions de Renan
- Si vraiment la langue ne fait pas partie de ce qui fonde le contrat national, rien n’interdit, a priori, la reconnaissance par la communauté politique née de ce contrat de la pluralité des langues des communautés fédérées, à partir du moment où existe une langue commune (et non unique) apte à permettre, fonctionnellement, la communication entre tous les citoyens.
- Et si vraiment une des valeurs centrales à la base du contrat est l’égalité entre les citoyens, il n’y a pas lieu d’établir une hiérarchie entre les langues de ces citoyens, une fois que l’accès de tous à la langue commune est garanti.
Un appel à la gauche
Dans cette perspective, les nations primaires auraient pu retrouver un statut, dans le cadre de la Fédération. Tout le propos de Lafont est précisément d’appeler la gauche de son temps, si elle revient au pouvoir, à un retour sur le contrat, pour l’appliquer enfin dans le sens de la reconnaissance des langues régionales.
La perversion du système initial : développement d’un pouvoir vertical et politique d’expansion coloniale
Car ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées, dans le monde réel. Et ce que Lafont va décrire, c’est en quelque sorte la perversion du système initial, et un repli progressif du nouveau régime sur quelque chose qui somme toute le ramène à la situation antérieure : la substitution d’un pouvoir vertical où le sommet dirige sans partage à une construction politique partant de la base et de l’appropriation du pouvoir par les citoyens, chez eux puis par délégations successives aux échelons supérieurs. Et le retour à une politique d’expansion territoriale par la conquête qui était celle des anciens monarques : l’impérialisme.
Pour résumer : la Nation comme projet politique libérateur englouti par l’Etat, c’est à dire un corset d’institutions contraignantes au service d’une minorité de dominants – la bourgeoisie en l’occurrence – continuant à se réclamer de valeurs, et du vocabulaire qui les exprime, qu’elle a en fait vidé de leur sens initial. Ce qu’il est convenu d’appeler l’État-Nation, mot-valise servant à dissimuler la réalité de ce qui s’est passé.
Retour sur l’Histoire
Au cœur de ce processus, le jacobinisme, du nom du Club des Jacobins
C’est le lieu associatif où sont passés la plupart des leaders du mouvement révolutionnaire, quitte à en sortir à un moment donné, au fur et à mesure que la Révolution se radicalise. C’est là que Lafont (qui reconnaissait volontiers ce qu’il devait à Félix Castan sur ce point) apporte des éléments qui doivent amener tout lecteur attentif à abandonner définitivement l’acception ordinaire, quasi automatique, du terme « jacobinisme » dans le discours habituel aussi bien du monde politique que du monde journalistique.
Le projet initial du jacobinisme : un contrat politique
Car le jacobinisme au départ, c’est justement le projet dont nous avons parlé, celui qui pose à la base du contrat politique l’appropriation par les citoyens du pouvoir à tous les échelons dans une démarche ascendante partant du local pour arriver au national. On laisse ici de côté le fait qu’en réalité les citoyens en question sont d’abord les propriétaires, seuls détenteurs du droit de vote, soit une minorité du corps social (masculin, cela va sans dire à l’époque). La Constitution de 1791 établit ainsi un étagement de pouvoirs gigognes : communes, districts, départements, Nation, tous émanant du suffrage, l’articulation entre les différents niveaux étant assurée par des représentants du gouvernement à chaque échelon. La Constitution de l’An I (été 1793) confirme et développe le système ainsi établi, qui aurait été du même coup le plus authentiquement démocratique de notre Histoire.
Mais l’Histoire en décide autrement… le Club des Jacobins se replie sur les Montagnards
Sauf que… à peine adoptée par la Convention, la Constitution est enfermée dans une arche, en attendant le jour où son application sera enfin devenue possible, une fois surmontés les périls extérieurs (la guerre avec les despotes d’Europe) et intérieurs (l’action des forces contre-révolutionnaires).
Et c’est là que s’amorce le virage. Un virage assumé par les Jacobins. Mais ce ne sont plus les Jacobins des débuts : par scissions et exclusions successives, le Club s’est replié sur un noyau dur, celui des Montagnards.
Au moment de l’adoption de la constitution de l’An 1, ils viennent d’éliminer leurs adversaires principaux, les Brissotins, ou Girondins, tous anciens Jacobins. Ce qui les sépare n’est pas, contrairement au cliché ordinaire, la différence entre des Girondins « régionalistes » et des montagnards centralisateurs : le fait que les premiers se soient revendiqués « fédéralistes » est ici trompeur, même s’il a servi de prétexte à la méfiance, pour les deux siècles suivants, face à toute revendication décentralisatrice.
Ce qui constitue la vraie ligne de clivage, c’est la vision des fins ultimes de la Révolution : les Girondins, liés à la grande bourgeoisie, considérant qu’elle est achevée, les Montagnards, appuyés sur la petite bourgeoisie et les classes populaires supérieures (les sans-culottes), considérant, eux, qu’elle doit aussi bâtir l’égalité sociale, et pas seulement civique.
Un virage impérialiste et autoritaire
Le virage qui s’ensuit prend plusieurs aspects
- au niveau extérieur, la Nation porteuse des idéaux universalistes et de libération des peuples opprimés par les despotes coalisés laisse la place, au fil des combats avec les puissances européennes, à un État suivant une simple logique militaire de conquête de zones tampons face aux centres de pouvoir de ces puissances. Les armées révolutionnaires se trouvent amenées, par la force des choses, à se ravitailler aux dépens des territoires conquis, la « libération » dérivant donc en pillage pur et simple sous le signe d’une occupation militaire peu soucieuse du respect des principes démocratiques. Que cette dérive s’effectue dans la bonne conscience affichée des acteurs n’enlève rien à sa réalité, celle d’un impérialisme naissant, ou re-naissant. Mais le mythe universaliste initial survit à la dérive ultérieure, et peut donc servir à la masquer.
- Au niveau intérieur, le fait qu’un certain nombre d’administrations élues, au niveau des départements, des districts ou des communes, prennent fait et cause pour la dissidence « fédéraliste » amène le pouvoir montagnard à les épurer, pour mettre à leur place des militants sûrs. Le fait que ce travail d’épuration soit mené par des représentants en mission, des députés de la Convention, donc des élus, ne change rien au fait que les citoyens des territoires concernés ne sont pas consultés. Et la suspicion généralisée multiplie les accusations de menées contre-révolutionnaires, et interdit de fait l’expression de toute opinion contradictoire : pas de liberté pour les ennemis de la liberté, selon la formule de Saint-Just, qui se réserve donc le droit de dire seul ce que doit être la liberté. C’est progressivement au cœur même du groupe montagnard que les divergences entre tendances aboutissent à la liquidation des minoritaires.
Ainsi se révèle la contradiction fondamentale de la démocratie : qui dit liberté de pensée et d’expression dit possibilité de revendication contre la démocratie, donc de conflit, et tentation, pour le groupe majoritaire, de résoudre le conflit par la violence, aux dépens donc de la démocratie.
La question de la langue
Le français langue des « Lumières »
Pour ce qui est de la langue, les révolutionnaires, issus pour l’essentiel de la bourgeoisie, ont bénéficié d’une formation classique qui leur assure la maîtrise du français des élites, quelles que soient leurs origines géographiques et leur connaissance héritée d’une autre langue. Il est donc naturel que la prééminence du français, langue au surplus des Lumières, ait été pour eux une évidence qu’il n’était même pas pensable d’interroger.
Par rapport aux autres langues : de l’utilisation pragmatique à « l’anéantissement »
Certes, au départ, le nouveau régime tolère l’existence des langues différentes parlées sur le sol national, et peut même les utiliser de façon toute pragmatique soit pour la traduction des nouveaux textes législatifs (c’est le cas en Bretagne ou au pays basque, et cela avait été envisagé pour l’espace occitan) soit à des fins de propagande.
Mais assez vite, l’idée que les « patois » sont incompatibles avec le monde nouveau à construire et qu’il convient donc de les « anéantir » fait son chemin. Avec des motivations diverses chez les acteurs, d’ailleurs, si on va au-delà des grandes déclarations philosophiques qui les masquent.
– Le grand rapport de Barère au début de 1794 (le consulter sur ce lien et en annexe), au nom du Comité de Salut Public, le véritable gouvernement de la Révolution montagnarde, vise d’abord les langues parlées sur les frontières, et susceptibles de permettre la connivence avec les puissances ennemies partageant la même langue (Barère, du coup, se soucie peu de l’occitan). Son point de vue est donc plus policier que politique ou idéologique.
– Celui de Grégoire (Voir sur ce lien et en annexe) est plus radical. Le point de départ de son enquête de 1790 – une initiative toute personnelle au demeurant – c’est sa découverte en mars de la même année des émeutes anti-féodales qui agitent le Périgord et le Quercy (vieilles régions de Croquants, au passage), émeutes que les autorités locales disent (spécieusement) impossibles à calmer, les révoltés ignorant le français.
La motivation première de Grégoire – au-delà, répétons-le, de ses grandes déclamations philosophiques – c’est la volonté de maintien de l’ordre social, face à des mouvements trop révolutionnaires à son goût. Et pour lui, plus que pour Barère, la diffusion du français et la mort des « patois » doit assurer l’hégémonie idéologique de la bourgeoisie à travers l’adoption, par les classes subalternes, de la langue des dominants et d’elle seule, avec les valeurs dont elle est porteuse.
Et tant pis, au passage, pour l’égalité entre les citoyens. À aucun moment, chez aucun des révolutionnaires qui posent la question de la langue, n’affleure l’idée que les « patois » pourraient être les langues de peuples distincts, potentiellement tentés de construire leur propre État « national ». Tous partagent l’idée simple qu’il s’agit d’idiomes réservés au « peuple des campagnes ».
La question de la langue, alors comme plus tard, mais aussi comme auparavant depuis au moins le XVIe siècle, est une question de classe, pas une question « ethnique ».
Après la Révolution, retour au pouvoir vertical et absolu inspiré de la monarchie
Dans tous les cas, le virage pris en 1793-1794 conditionne les évolutions futures du pays, bien après l’élimination, à l’été 1794, des Montagnards qui l’ont d’abord négocié.
Le Directoire, puis le Consulat et l’Empire, abandonnent sans remords tous les arguments politiques et sociaux qui justifiaient, pour les Montagnards, l’instauration de la Terreur ; ils ne gardent que le désir de contrôle par le sommet des institutions de terrain, en renforçant ce contrôle : ceux que Bonaparte chargera de l’exercer, les préfets, ne sont plus des élus du peuple comme les représentants en mission de 1793, mais des fonctionnaires d’autorité nommés par le centre, sans réel contrepoids démocratique à la base. Et pendant une bonne partie du siècle, les municipalités et les conseils généraux seront constitués de la même façon, par en haut.
Si le processus de centralisation entamé par le pouvoir révolutionnaire sous la pression des périls extérieurs et intérieurs avait vocation à être purement temporaire, le système que Bonaparte met en place au début du XIXe et que tous les régimes ultérieurs vont soigneusement préserver n’a d’autre justification que lui-même, et le souci du maintien d’un ordre social et politique qui ne laisse à l’expression de la volonté des citoyens, au niveau local comme au niveau national, que la place la plus minime possible.
Comme Quinet ou Tocqueville l’avaient perçu en leur temps, on a là affaire bel et bien à une forme de retour au pouvoir vertical et absolu des vieux monarques, sous le signe de l’obsession d’un retour au désordre révolutionnaire qu’il faut absolument éviter, et, donc, d’une méfiance profonde autant que bien cachée vis à vis du « peuple ».
Les langues « locales », signes d’infériorité sociale
Et c’est la vision des langues locales comme signe de l’infériorité sociale de ceux qui les parlent qui commande la politique linguistique des régimes ultérieurs, que leur maintien les laisse indifférents, pour ceux qui entendent réserver le pouvoir et le droit à la parole aux seules classes dominantes, ou que, avec la IIIe République le désir affiché (et peut-être sincère) de permettre la promotion sociale des dominés justifie la diffusion d’un français normé ignorant ou combattant les pratiques linguistiques réelles des enfants des écoles.
Pour en finir avec la confusion terminologique
On est donc loin du rêve des Jacobins originels, ceux qui faisaient la Révolution.
Et il convient donc d’éviter de qualifier de « Jacobins » ceux qui se réclament du système introduit après la défaite finale des révolutionnaires et le retour à un ordre, qui, pour être bourgeois et non plus aristocratique, n’en est pas moins l’Ordre. Nous suggérons donc de réserver à ceux-là le qualificatif de « bonapartistes », même quand ils se revendiquent de la gauche la mieux caractérisée, sans mesurer exactement le sens réel de ce qu’ils préconisent.
Et pour revisiter l’héritage des Jacobins historiques
Ceci étant, si les Jacobins historiques, ceux des premières années tout du moins, sont innocents pour ce qui concerne le triomphe final de la centralisation, ce n’est pas pour autant qu’ils sont sans reproche, et dans leur héritage, il y a des choses dont on se serait volontiers passé.
La conception de l’individu-citoyen
Leur conception de l’individu-citoyen interdit tout regroupement, toute « fraction » devenant vite « faction », sur la base d’intérêts particuliers, bref, tout corps intermédiaire susceptible de constituer un contre-pouvoir.
L’application la plus emblématique de ce principe est la loi Le Chapelier de 1791, Le Chapelier ayant été un de fondateurs et des premiers présidents du Club, avant de le quitter et d’être exécuté en 1794. Comme on sait, cette loi interdit les « coalitions » entre salariés dans le but d’obtenir du patron de meilleurs salaires, au motif que seuls valent les accords conclus entre individus (libres et égaux…) : c’est donc une loi antisyndicale, une des premières avec un article de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, mieux connue pour une autre de ses dispositions. Où l’on voit comment l’apparente promotion et exaltation de l’individu dégagé de toutes ses appartenances antérieures peut servir de prétexte à une application concrète visant à le laisser seul face au pouvoir, sans possibilité de trouver ailleurs le secours nécessaire. Ceux qui aujourd’hui, à droite comme à gauche d’ailleurs, vitupèrent les corps intermédiaires feraient mieux de se souvenir des implications de cette vieille loi. Il y a dans La Révolution régionaliste des pages où Lafont montre bien comment l’individualisme aboutit, de fait, à soumettre le citoyen au bon vouloir d’autorités sur lesquelles, isolé, il n’a aucune prise, et d’autre recours que de grommeler in petto contre leurs exigences.
La conception de l’avant-gardisme
Second héritage problématique – mais Lafont n’en parle pas parce que ce n’est pas son sujet – l’avant-gardisme, l’idée, flatteuse, que les Jacobins, étant les révolutionnaires les plus conscients et les plus éduqués, les plus vertueux aussi, ajoutent les robespierristes, sont en quelque sorte les mieux à même de mener le combat, et de savoir ce qui est bon pour le peuple, mieux que le peuple, car, comme disait Robespierre, « le peuple est bon mais il se laisse facilement égarer par les fourbes ».
On voit bien le lien entre cette conception de l’avant-garde éclairée et la façon dont se justifie, en 1793 et 1794, l’épuration des administrations locales comme moyen de réserver le pouvoir aux seuls représentants du bon parti.
Ce n’est pas un hasard si les bolcheviks se sont constamment référés à l’exemple de la Révolution française et du jacobinisme pour justifier leur idée du parti de type nouveau recrutant une élite de révolutionnaires professionnels, avec toutes les dérives que cela a impliqué une fois le pouvoir conquis. On note même comment l’URSS adopte en 1937 une constitution qui se trouve être la plus démocratique jamais imaginée, sauf qu’il est décidé tout de suite de suspendre son application, jusqu’au jour où le socialisme aura définitivement triomphé – ce qui laissait à Staline un peu de temps pour poursuivre ses activités ordinaires.
Il est difficile d’imaginer que le parallèle avec le sort réservé à la Constitution de l’An I soit purement accidentel.
Et, plus profondément, il est permis de se demander si en fait l’avant-gardisme jacobin ne doit pas quelque chose au précédent illustre des Jésuites, avec leur organisation militaire, et, plus profondément encore, à tout un héritage venu de l’organisation hiérarchique sacralisée de l’Eglise catholique, comme d’ailleurs de toutes les castes sacerdotales de toutes les religions, toutes celles qui se proclament seules détentrices de la voie vers le Salut.
Alain Besançon, pour la Russie, voyait de même dans le stalinisme (et son promoteur ancien séminariste) la trace non avouée d’un héritage venu de l’Eglise orthodoxe ; et ce n’est peut-être pas fini, sous une autre forme, dans le même pays… S’il y avait lieu d’adresser des reproches aux Jacobins (mais quel intérêt au fond, si longtemps après…) c’est sur ce sujet que je les formulerais pour ma part, compte tenu des catastrophes que ce mythe de l’avant-garde éclairée a pu provoquer. Par rapport à ces catastrophes, l’accusation de pères du centralisme français pèse vraiment peu.
D’où vient alors le succès du cliché jacobinisme = centralisme ?
Peut-être de la fin du Second Empire, quand le parti républicain en cours de reconstruction voit s’affronter en son sein deux tendances, précisément sur la question de la centralisation : certains considérant que la centralisation représente en fait un retour à l’Ancien Régime et une défaite de la démocratie, tandis que d’autres pensent au contraire la centralisation nécessaire face au risque d’émergence, dans les provinces, de mouvements réactionnaires de type vendéen. Ceux-là se définissent comme « néojacobins ». Et compte tenu des difficultés que la République naissante rencontre à la chute de l’Empire, entre la tentative révolutionnaire « fédéraliste » de la Commune et le risque d’une restauration des Bourbons ou des Orléans, c’est la vision néojacobine qui triomphe, y compris chez des hommes – Ferry, Gambetta – qui étaient auparavant dans l’autre camp. Il ne reste plus ensuite qu’à retrouver le souvenir des Girondins, à la fois comme révolutionnaires étrangers à la Terreur (puisqu’ils en furent les premières victimes) et comme partisans (peut-être…) d’une France décentralisée, et voilà un double cliché installé, jusqu’à nos jours, aux dépens de la réalité des uns et des autres. Mais la référence à l’évènement sacré qu’est la Révolution justifie tout.
On aurait pourtant tout intérêt à aller plus loin, quitte à se libérer de l’ombre des Pères Fondateurs d’il y a maintenant plus de deux siècles…
[1]Il n’est pas impossible que cette idée d’une « nation » caractérisée par sa langue soit une référence à la théorie de Fontan, fondateur du Parti Nationaliste Occitan, qui a pu séduire dans les années soixante quelques jeunes occitanistes. Le concept de nation secondaire permet par contre de rétablir le lien avec la France.
Annexes
Rapport du Comité de salut public sur les idiomes – Le 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) – Bertrand Barère de Vieuzac
Citoyens, les tyrans coalisés ont dit : l’ignorance fut toujours notre auxiliaire le plus puissant ; maintenons l’ignorance ; elle fait les fanatiques, elle multiplie les contre-révolutionnaires ; faisons rétrograder les Français vers la barbarie : servons-nous des peuples mal instruits ou de ceux qui parlent un idiome différent de celui de l’instruction publique.
Le comité a entendu ce complot de l’ignorance et du despotisme.
Je viens appeler aujourd’hui votre attention sur la plus belle langue de l’Europe, celle qui, la première, a consacré franchement les droits de l’homme et du citoyen, celle qui est chargée de transmettre au monde les plus sublimes pensées de la liberté et les plus grandes spéculations de la politique.
Longtemps elle fut esclave, elle flatta les rois, corrompit les cours et asservit les peuples ; longtemps elle fut déshonorée dans les écoles, et mensongère dans les livres de l’éducation publique ; astucieuse dans les tribunaux, fanatique dans les temples, barbare dans les diplômes, amollie par les poètes, corruptrice sur les théâtres, elle semblait attendre ou plutôt désirer une plus belle destinée.
Épurée enfin, et adoucie par quelques auteurs dramatiques, ennoblie et brillante dans les discours de quelques orateurs, elle venait de reprendre de l’énergie, de la raison et de la liberté sous la plume de quelques philosophes que la persécution avait honorés avant la révolution de 1789.
Mais elle paraissait encore n’appartenir qu’à certaines classes de la société; elle avait pris la teinte des distinctions nobiliaires ; et le courtisan, non content d’être distingué par ses vices et ses dépravations, cherchait encore à se distinguer dans le même pays par un autre langage. On eût dit qu’il y avait plusieurs nations dans une seule.
Cela devait exister dans un gouvernement monarchique, où l’on faisait ses preuves pour entrer dans une maison d’éducation, dans un pays où il fallait un certain ramage pour être de ce qu’on appelait la bonne compagnie, et où il fallait siffler la langue d’une manière particulière pour être un homme comme il faut.
Ces puériles distinctions ont disparu avec les grimaces des courtisans ridicules et les hochets d’une cour perverse. L’orgueil même de l’accent plus ou moins pur ou sonore n’existe plus, depuis que des citoyens rassemblés de toutes les parties de la République ont exprimé dans les assemblées nationales leurs vœux pour la liberté et leurs pensées pour la législation commune. Auparavant, c’étaient des esclaves brillants de diverses nuances ; ils se disputaient la primauté de mode et de langage. Les hommes libres se ressemblent tous ; et l’accent vigoureux de la liberté et de l’égalité est le même, soit qu’il sorte de la bouche d’un habitant des Alpes ou des Vosges, des Pyrénées ou du Cantal, du Mont-Blanc ou du Mont-Terrible, soit qu’il devienne l’expression des hommes dans des contrées centrales, dans des contrées maritimes ou sur les frontières.
Quatre points du territoire de la République méritent seuls de fixer l’attention du législateur révolutionnaire sous le rapport des idiomes qui paraissent les plus contraires à la propagation de l’esprit public et présentent des obstacles à la connaissance des lois de la République et à leur exécution.
Parmi les idiomes anciens, welches, gascons, celtiques, wisigoths, phocéens ou orientaux, qui forment quelques nuances dans les communications des divers citoyens et des pays formant le territoire de la République, nous avons observé (et les rapports des représentants se réunissent sur ce point avec ceux des divers agents envoyés dans les départements) que l’idiome appelé bas-breton, l’idiome basque, les langues allemande et italienne ont perpétué le règne du fanatisme et de la superstition, assuré la domination des prêtres, des nobles et des praticiens, empêché la révolution de pénétrer dans neuf départements importants, et peuvent favoriser les ennemis de la France.
Je commence par le bas-breton. Il est parlé exclusivement dans la presque totalité des départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, d’Îlle-et-Vilaine, et dans une grande partie de la Loire-Inférieure. Là l’ignorance perpétue le joug imposé par les prêtres et les nobles ; là les citoyens naissent et meurent dans l’erreur : ils ignorent s’il existe encore des lois nouvelles.
Les habitants des campagnes n’entendent que le bas-breton ; c’est avec cet instrument barbare de leurs pensées superstitieuses que les prêtres et les intrigants les tiennent sous leur empire, dirigent leurs consciences et empêchent les citoyens de connaître les lois et d’aimer la République. Vos travaux leur sont inconnus, vos efforts pour leur affranchissement sont ignorés. L’éducation publique ne peut s’y établir, la régénération nationale y est impossible. C’est un fédéralisme indestructible que celui qui est fondé sur le défaut de communication des pensées ; et si les divers départements, seulement dans les campagnes, parlaient divers idiomes, de tels fédéralistes ne pourraient être corrigés qu’avec des instituteurs et des maîtres d’école dans plusieurs années seulement.
Les conséquences de cet idiome, trop longtemps perpétué et trop généralement parlé dans les cinq départements de l’Ouest, sont si sensibles que les paysans (au rapport de gens qui y ont été envoyés) confondent le mot loi et celui de religion, à un tel point que, lorsque les fonctionnaires publics leur parlent des lois de la République et des décrets de la Convention, ils s’écrient dans leur langage vulgaire : Est-ce qu’on veut nous faire sans cesse changer de religion ?
Quel machiavélisme dans les prêtres d’avoir fait confondre la loi et la religion dans la pensée de ces bons habitants des campagnes ! Jugez, par ce trait particulier, s’il est instant de s’occuper de cet objet. Vous avez ôté à ces fanatiques égarés les saints par le calendrier de la République ; ôtez-leur l’empire des prêtres par l’enseignement de la langue française.
Dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, qui a donc appelé, de concert avec les traîtres, le Prussien et l’Autrichien sur nos frontières envahies ? l’habitant des campagnes qui parle la même langue que nos ennemis, et qui se croit ainsi bien plus leur frère et leur concitoyen que le frère et le concitoyen des Français qui lui parlent une autre langue et ont d’autres habitudes.
Le pouvoir de l’identité du langage a été si grand qu’à la retraite des Allemands plus de vingt mille hommes des campagnes du Bas-Rhin sont émigrés. L’empire du langage et l’intelligence qui régnait entre nos ennemis d’Allemagne et nos concitoyens du département du Bas-Rhin est si incontestable qu’ils n’ont pas été arrêtés dans leur émigration par tout ce que les hommes ont de plus cher, le sol qui les a vus naître, les dieux pénates et les terres qu’ils avaient fertilisées. La différence des conditions, l’orgueil, ont produit la première émigration qui a donné à la France des milliards ; la différence du langage, le défaut d’éducation, l’ignorance ont produit la seconde émigration qui laisse presque tout un département sans cultivateurs. C’est ainsi que la contre-révolution s’est établie sur quelques frontières en se réfugiant dans les idiomes celtiques ou barbares que nous aurions dû faire disparaître.
Vers une autre extrémité de la République est un peuple neuf, quoique antique, un peuple pasteur et navigateur, qui ne fut jamais ni esclave ni maître, que César ne put vaincre au milieu de sa course triomphante dans les Gaules, que l’Espagne ne put atteindre au milieu de ses révolutions, et que le despotisme de nos despotes ne put soumettre au joug des intendants : je veux parler du peuple basque. Il occupe l’extrémité dés Pyrénées-Occidentales qui se jette dans l’Océan. Une langue sonore et imagée est regardée comme le sceau de leur origine et l’héritage transmis par leurs ancêtres. Mais ils ont des prêtres, et les prêtres se servent de leur idiome pour les fanatiser ; mais ils ignorent la langue française et la langue des lois de la République. Il faut donc qu’ils l’apprennent, car, malgré la différence du langage et malgré leurs prêtres, ils sont dévoués à la République qu’ils ont déjà défendue avec valeur le long de la Bidassoa et sur nos escadres.
Un autre département mérite d’attirer vos regards : c’est le département de Corse. Amis ardents de la liberté, quand un perfide Paoli et des administrateurs fédéralistes ligués avec des prêtres ne les égarent pas, les Corses sont des citoyens français ; mais, depuis quatre ans de révolution, ils ignorent nos lois, ils ne connaissent pas les événements et les crises de notre liberté.
Trop voisins de l’Italie, que pouvaient-ils en recevoir ? des prêtres, des indulgences, des Adresses séditieuses, des mouvements fanatiques. Pascal Paoli, Anglais par reconnaissance, dissimulé par habitude, faible par son âge, Italien par principe, sacerdotal par besoin, se sert puissamment de la langue italienne pour pervertir l’esprit public, pour égarer le peuple, pour grossir son parti ; il se sert surtout de l’ignorance des habitants de Corse, qui ne soupçonnent pas même l’existence des lois françaises, parce qu’elles sont dans une langue qu’ils n’entendent pas.
Il est vrai qu’on traduit depuis quelques mois notre législation en italien ; mais ne vaut-il pas mieux y établir des instituteurs de notre langue que des traducteurs d’une langue étrangère ?
Citoyens, c’est ainsi que naquit la Vendée ; son berceau fut l’ignorance des lois ; son accroissement fut dans les moyens employés pour empêcher la révolution d’y pénétrer, et alors les dieux de l’ignorance, les prêtres réfractaires, les nobles conspirateurs, les praticiens avides et les administrateurs faibles ou complices ouvrirent une plaie hideuse dans le sein de la France : écrasons donc l’ignorance, établissons des instituteurs de langue française dans les campagnes !
Depuis trois ans les assemblées nationales parlent et discutent sur l’éducation publique ; depuis longtemps le besoin des écoles primaires se fait sentir ; ce sont des subsistances morales de première nécessité que les campagnes vous demandent ; mais peut-être sommes-nous encore trop académiques et trop loin du peuple pour lui donner les institutions les plus adaptées à ses plus pressants besoins.
Les lois de l’éducation préparent à être artisan, artiste, savant, littérateur, législateur et fonctionnaire public ; mais les premières lois de l’éducation doivent préparer à être citoyens ; or, pour être citoyen, il faut obéir aux lois, et, pour leur obéir, il faut les connaître. Vous devez donc au peuple l’éducation première qui le met à portée d’entendre la voix du législateur. Quelle contradiction présentent à tous les esprits les départements du Haut et du Bas-Rhin, ceux du Morbihan, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure, des Côtes-du-Nord, des Basses-Pyrénées et de la Corse ? Le législateur parle une langue que ceux qui doivent exécuter et obéir n’entendent pas. Les anciens ne connurent jamais des contrastes aussi frappants et aussi dangereux.
Il faut populariser la langue, il faut détruire cette aristocratie de langage qui semble établir une nation polie au milieu d’une nation barbare.
Nous avons révolutionné le gouvernement, les lois, les usages, les mœurs, les costumes, le commerce et la pensée même ; révolutionnons donc aussi la langue, qui est leur instrument journalier.
Vous avez décrété l’envoi des lois à toutes les communes de la République ; mais ce bienfait est perdu pour celles des départements que j’ai déjà indiqués. Les lumières portées à grands frais aux extrémités de la France s’éteignent en y arrivant, puisque les lois n’y sont pas entendues.
Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l’émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle l’italien, et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreur.
Le comité a pensé qu’il devait vous proposer, comme mesure urgente et révolutionnaire, de donner à chaque commune de campagne des départements désignés un instituteur de langue française, chargé d’enseigner aux jeunes personnes des deux sexes, et de lire, chaque décade, à tous les autres citoyens de la commune, les lois, les décrets et les instructions envoyés de la Convention. Ce sera à ces instituteurs de traduire vocalement ces lois pour une intelligence plus facile dans les premiers temps. Rome instruisait la jeunesse en lui apprenant à lire dans la loi des douze tables. La France apprendra à une partie des citoyens la langue française dans le livre de la Déclaration des Droits.
Ce n’est pas qu’il n’existe d’autres idiomes plus ou moins grossiers dans d’autres départements ; mais ils ne sont pas exclusifs, mais ils n’ont pas empêché de connaître la langue nationale. Si elle n’est pas également bien parlée partout, elle est du moins facilement entendue. Les clubs, les Sociétés patriotiques, sont des écoles primaires pour la langue et pour la liberté ; elles suffiront pour la faire connaître dans les départements où il reste encore trop de vestiges de ces patois, de ces jargons maintenus par l’habitude et propagés par une éducation négligée ou nulle. Le législateur doit voir d’en haut, et ne doit ainsi apercevoir que les nuances très prononcées, que les différences énormes ; il ne doit des instituteurs de langue qu’au pays, qui, habitué exclusivement à un idiome, est pour ainsi dire isolé et séparé de la grande famille.
Ces instituteurs n’appartiendront à aucune fonction de culte quelconque ; point de sacerdoce dans l’enseignement public ; de bons patriotes, des hommes éclairés, voilà les premières qualités nécessaires pour se mêler d’éducation.
Les Sociétés populaires indiqueront des candidats : c’est de leur sein, c’est des villes que doivent sortir ces instituteurs ; c’est par les représentants du peuple, envoyés pour établir le gouvernement révolutionnaire, qu’ils seront choisis.
Leur traitement sera payé par le trésor public. La République doit l’instruction élémentaire à tous les citoyens ; leur traitement n’éveillera pas la cupidité ; il doit satisfaire aux besoins d’un homme dans les campagnes ; il sera de 100 frs par mois. L’assiduité prouvée par des autorités constituées sera la caution de la République dans le paiement qu’elle fera à ces instituteurs, qui vont remplir une mission plus importante qu’elle ne paraît d’abord. Ils vont créer des hommes à la liberté, attacher des citoyens à la patrie, et préparer l’exécution des lois en les faisant connaître.
Cette proposition du comité aura peut-être une apparence frivole aux yeux des hommes ordinaires, mais je parle à des législateurs populaires, chargés de présider à la plus belle des révolutions que la politique et l’esprit humain aient encore éprouvées.
Si je parlais à un despote, il me blâmerait ; dans la monarchie même chaque maison, chaque commune, chaque province, était en quelque sorte un empire séparé de moeurs, d’usages, de lois, de coutumes et de langage. Le despote avait besoin d’isoler les peuples, de séparer les pays, de diviser les intérêts, d’empêcher les communications, d’arrêter la simultanéité des pensées et l’identité des mouvements. Le despotisme maintenait la variété des idiomes : une monarchie doit ressembler à la tour de Babel ; il n’y a qu’une langue universelle pour le tyran : celle de la force pour avoir l’obéissance, et celle des impôts pour avoir de l’argent.
Dans la démocratie, au contraire, la surveillance du gouvernement est confiée à chaque citoyen ; pour le surveiller il faut le connaître, il faut surtout en connaître la langue.
Les lois d’une République supposent une attention singulière de tous les citoyens les uns sur les autres, et une surveillance constante sur l’observation des lois et sur la conduite des fonctionnaires publics. Peut-on se la promettre dans la confusion des langues, dans la négligence de la première éducation du peuple, dans l’ignorance des citoyens ?
D’ailleurs, combien de dépenses n’avons-nous pas faites pour la traduction des lois des deux premières assemblées nationales dans les divers idiomes parlés en France ! Comme si c’était à nous à maintenir ces jargons barbares et ces idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les fanatiques et les contre-révolutionnaires !
Laisser les citoyens dans l’ignorance de la langue nationale, c’est trahir la patrie ; c’est laisser le torrent des lumières empoisonné ou obstrué dans son cours ; c’est méconnaître les bienfaits de l’imprimerie, car chaque imprimeur est un instituteur public de langue et de législation.
Laisserez-vous sans fruit sur quelque partie du territoire, cette belle invention qui multiplie les pensées et propage les lumières, qui reproduit les lois et les décrets, et les étend dans huit jours sur toute la surface de la République ; une invention qui rend la Convention nationale présente à toutes les communes, et qui seule peut assurer les lumières, l’éducation, l’esprit public et le gouvernement démocratique d’une grande nation ?
Citoyens, la langue d’un peuple libre doit être une et la même pour tous.
Dès que les hommes pensent, dès qu’ils peuvent coaliser leurs pensées, l’empire des prêtres, des despotes et des intrigants touche à sa ruine.
Donnons donc aux citoyens l’instrument de la pensée publique, l’agent le plus sûr de la révolution, le même langage.
Eh quoi ! tandis que les peuples étrangers apprennent sur tout le globe la langue française ; tandis que nos papiers publics circulent dans toutes les régions ; tandis que le Journal Universel et le Journal des Hommes Libres sont lus chez toutes les nations d’un pôle à l’autre, on dirait qu’il existe en France six cent mille Français qui ignorent absolument la langue de leur nation et qui ne connaissent ni les lois, ni la révolution qui se font au milieu d’eux !
Ayons l’orgueil que doit donner la prééminence de la langue française depuis qu’elle est républicaine, et remplissons un devoir.
Laissons la langue italienne consacrée aux délices de l’harmonie et aux expressions d’une poésie molle et corruptrice.
Laissons la langue allemande, peu faite pour des peuples libres jusqu’à ce que le gouvernement féodal et militaire, dont elle est le plus digne organe, soit anéanti.
Laissons la langue espagnole pour son inquisition et ses universités jusqu’à ce qu’elle exprime l’expulsion des Bourbons qui ont détrôné les peuples de toutes les Espagnes.
Quant à la langue anglaise, qui fut grande et libre le jour qu’elle s’enrichit de ces mots, la majesté du peuple, elle n’est plus que l’idiome d’un gouvernement tyrannique et exécrable, de la banque et des lettres-de-change.
Nos ennemis avaient fait de la langue française la langue des cours ; ils l’avaient avilie. C’est à nous d’en faire la langue des peuples, et elle sera honorée.
Il n’appartient qu’à une langue qui a prêté ses accents à la liberté et à l’égalité ; à une langue qui a une tribune législative et deux mille tribunes populaires, qui a de grandes enceintes pour agiter de vastes assemblées, et des théâtres pour célébrer le patriotisme ; il n’appartient qu’à la langue française qui, depuis quatre ans, se fait lire par tous les peuples, qui décrit à toute l’Europe la valeur de quatorze armées, qui sert d’instrument à la gloire de la reprise de Toulon, de Landau, du Fort Vauban et à l’anéantissement des armées royales ; il n’appartient qu’à elle de devenir la langue universelle.
Mais cette ambition est celle du génie de la liberté ; il la remplira. Pour nous, nous devons à nos concitoyens, nous devons à l’affermissement de la République de faire parler sur tout son territoire la langue dans laquelle est écrite la Déclaration des droits de l’Homme.
Voici le projet :
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète :
Art. I. Il sera établi dans dix jours, à compter du jour de la publication du présent décret, un instituteur de langue française dans chaque commune de campagne des départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord et dans la partie de la Loire-Inférieure dont les habitants parlent l’idiome appelé bas-breton.
Art. II. Il sera procédé à la même nomination d’un instituteur de la langue française dans chaque commune des campagnes des départements du Haut et Bas-Rhin, dans le département de la Corse, dans la partie du département de la Moselle, du département du Nord, du Mont-Terrible, des Alpes maritimes, et de la partie des Basses-Pyrénées dont les habitants parlent un idiome étranger.
Art. III. Il ne pourra être choisi un instituteur parmi les ministres d’un culte quelconque, ni parmi ceux qui auront appartenu à des castes ci-devant privilégiées ; ils seront nommés par les représentants du peuple, sur l’indication faîte par les sociétés populaires.
Art. IV. Les instituteurs seront tenus d’enseigner tous les jours la langue française et la Déclaration des droits de l’Homme à tous les jeunes citoyens des deux sexes que les pères, mères et tuteurs seront tenus d’envoyer dans les écoles publiques ; les jours de décade ils donneront lecture au peuple et traduiront vocalement les lois de la république en préférant celles relatives à l’agriculture et aux droits des citoyens.
Art. V. Les instituteurs recevront du trésor public un traitement de 1500 livres par an, payables à la fin de chaque mois, à la caisse du district, sur le certificat de résidence donné par les municipalités, d’assiduité et de zèle à leurs fonctions donné par l’agent national près chaque commune. Les sociétés populaires sont invitées à propager l’établissement des clubs pour la traduction vocale des décrets et des lois de la république, et à multiplier les moyens de faire connaître la langue française dans les campagnes les plus reculées.
Le Comité de salut public est chargé de prendre à ce sujet toutes les mesures qu’il croira nécessaires. (Projet décrété)
Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser la langue française Le 16 prairial an II (4 juin 1794) Abbé Grégoire
Séance du 16 prairial, l’an deuxième de la République, une et indivisible ; suivi du décret de la Convention nationale, imprimés par ordre de la Convention nationale, et envoyés aux autorités constituées, aux sociétés populaires et à toutes les communes de la République
La langue française a conquis l’estime de l’Europe, et depuis un siècle elle y est classique : mon but n’est pas d’assigner les causes qui lui ont assuré cette prérogative. Il y a dix ans qu’au fond de l’Allemagne, à Berlin, on discuta savamment cette question qui, suivant l’expression d’un écrivain, eût flatté l’orgueil de Rome, empressée à la consacrer dans son histoire comme une de ses belles époques. On connaît les tentatives de la politique romaine pour universaliser sa langue : elle défendait d’en employer d’autre pour haranguer les ambassadeurs étrangers, pour négocier avec eux ; et, malgré ses efforts, elle n’obtint qu’imparfaitement ce qu’un assentiment libre accorde à la langue française. On sait qu’en 1774, elle servit à rédiger le traité entre les Turcs et les Russes. Depuis la paix de Nimègue, elle a été prostituée, pour ainsi dire, aux intrigues des cabinets de l’Europe. Dans sa marche claire et méthodique, la pensée se déroule facilement ; c’est ce qui lui donne un caractère de raison, de probité, que les fourbes eux-mêmes trouvent plus propres à les garantir des ruses diplomatiques.
Si notre idiome a reçu un tel accueil des tyrans et des cours à qui la France monarchique donnait des théâtres, des pompons, des modes et des manières, quel accueil ne doit-il pas se promettre de la part des peuples à qui la France républicaine révèle leurs droits en leur ouvrant la route de la liberté ?
Mais cet idiome, admis dans les transactions politiques, usité dans plusieurs villes d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, dans une partie du pays de Liège, du Luxembourg, de la Suisse, même dans le Canada et sur les bords du Mississipi, par quelle fatalité est-il encore ignoré d’une très-grande partie des Français ?
A travers toutes les révolutions, le celtique, qui fut le premier idiome de l’Europe, s’est maintenu dans une contrée de la France et dans quelques cantons des Îles britanniques. On sait que les Gallois, les Cornouailliens et les Bas-Bretons s’entendent ; cette langue indigène éprouva des modifications successives. Les Phocéens fondèrent, il y a vingt-quatre siècles, de brillantes colonies sur les bords de la Méditerranée ; et, dans une chanson des environs de Marseille, on a trouvé récemment des fragments grecs d’une ode de Pindare sur les vendanges. Les Carthaginois franchirent les Pyrénées, et Polybe nous dit que beaucoup de Gaulois apprirent le punique pour converser avec les soldats d’Annibal.
Du joug des Romains, la Gaule passa sous la domination des Francs. Les Alains, les Goths, les Arabes et les Anglais, après y avoir pénétré tour à tour, en furent chassés ; et notre langue ainsi que les divers dialectes usités en France portent encore les empreintes du passage ou du séjour de ces divers peuples.
La féodalité, qui vint ensuite morceler ce beau pays, y conserva soigneusement cette disparité d’idiomes comme un moyen de reconnaître, de ressaisir les serfs fugitifs et de river leurs chaînes. Actuellement encore, l’étendue territoriale où certains patois sont usités, est déterminée par les limites de l’ancienne domination féodale. C’est ce qui explique la presque identité des patois de Bouillon et de Nancy, qui sont à 40 lieues de distance et qui furent jadis soumis aux mêmes tyrans ; tandis que le dialecte de Metz, situé à quelques lieues de Nancy, en diffère beaucoup, parce que, pendant plusieurs siècles, le pays Messin, organisé dans une forme républicaine, fut en guerre continuelle avec la Lorraine.
Il n’y a qu’environ quinze départements de l’intérieur où la langue française soit exclusivement parlée ; encore y éprouve-t-elle des altérations sensibles, soit dans la prononciation, soit par l’emploi des termes impropres et surannés, surtout vers Sancerre, où l’on retrouve une partie des expressions de Rabelais, Amyot et Montaigne.
Nous n’avons plus de provinces, et nous avons encore environ trente patois qui en rappellent les noms.
Peut-être n’est-il pas inutile d’en faire l’énumération : le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le messin [<Metz: variété de francique], le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphinois, l’auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le provençal, le languedocien, le velayen [<Velay : Velaisiens], le catalan, le béarnais, le basque, le rouergat [< Rouergue: variété de languedocien] et le gascon ; ce dernier seul est parlé sur une surface de 60 lieues en tout sens.
Au nombre des patois, on doit placer encore l’italien de la Corse, des Alpes-Maritimes, et l’allemand des Haut et Bas-Rhin, parce que ces deux idiomes y sont très-dégénérés.
Enfin les nègres de nos colonies, dont vous avez fait des hommes, ont une espèce d’idiome pauvre comme celui des Hottentots, comme la langue franque, qui, dans tous les verbes, ne connaît guère que l’infinitif.
Plusieurs de ces dialectes, à la vérité, sont génériquement les mêmes ; ils ont un fonds de physionomie ressemblante, et seulement quelques traits métis tellement nuancés que les divers faubourgs d’une même commune, telle que Salins et Commune-Affranchie, offrent des variantes.
Cette disparité s’est conservée d’une manière plus tranchante dans des villages situés sur les bords opposés d’une rivière, où, à défaut de pont, les communications étaient autrefois plus rares. Le passage de Strasbourg à Brest est actuellement plus facile que ne l’étaient jadis des courses de vingt lieues, et l’on cite encore vers Saint-Claude, dans le département du Jura, des testaments faits (est-il dit) à la veille d’un grand voyage ; car il s’agissait d’aller à Besançon, qui était la capitale de la province.
On peut assurer sans exagération qu’au moins six millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale ; qu’un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie ; qu’en dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent n’excède pas trois millions, et probablement le nombre de ceux qui l’écrivent correctement encore moindre.
Ainsi, avec trente patois différents, nous sommes encore, pour le langage, à la tour de Babel, tandis que, pour la liberté, nous formons l’avant-garde des nations.
Quoiqu’il y ait possibilité de diminuer le nombre des idiomes reçus en Europe, l’état politique du globe bannit l’espérance de ramener les peuples à une langue commune. Cette conception, formée par quelques écrivains, est également hardie et chimérique. Une langue universelle est, dans son genre, ce que la pierre philosophale est en chimie.
Mais au moins on peut uniformiser le langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plutôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté.
Sur le rapport de son Comité de salut public, la Convention nationale décréta, le 8 pluviôse, qu’il serait établi des instituteurs pour enseigner notre langue dans les départements où elle est le moins connue. Cette mesure, très-salutaire, mais qui ne s’étend pas à tous ceux où l’on parle patois, doit être secondée par le zèle des citoyens. La voix douce de la persuasion peut accélérer l’époque où ces idiomes féodaux auront disparu. Un des moyens les plus efficaces peut-être pour électriser les citoyens, c’est de leur prouver que la connaissance et l’usage de la langue nationale importent à la conservation de la liberté. Aux vrais républicains, il suffit de montrer le bien, on est dispensé de le leur commander.
Les deux sciences les plus utiles et les plus négligées sont la culture de l’homme et celle de la terre : personne n’a mieux senti le prix de l’une et de l’autre que nos frères les Américains, chez qui tout le monde sait lire, écrire et parler la langue nationale.
L’homme sauvage n’est, pour ainsi dire, qu’ébauché ; en Europe, l’homme civilisé est pire, il est dégradé.
La résurrection de la France s’est opérée d’une manière imposante ; elle se soutient avec majesté ; mais le retour d’un peuple à la liberté ne peut en consolider l’existence que par les mœurs et les Lumières. Avouons qu’il nous reste beaucoup à faire à cet égard.
Tous les membres du souverain sont admissibles à toutes les places ; il est à désirer que tous puissent successivement les remplir, et retourner à leurs professions agricoles ou mécaniques. Cet état de choses nous présente l’alternative suivante : si ces places sont occupées par des hommes incapables de s’énoncer, d’écrire dans la langue nationale, les droits des citoyens seront-ils bien garantis par des actes dont la rédaction présentera l’impropriété des termes, l’imprécision des idées, en un mot tous les symptômes de l’ignorance ? Si au contraire cette ignorance exclut des places, bientôt renaîtra cette aristocratie qui jadis employait le patois pour montrer son affabilité protectrice à ceux qu’on appelait insolemment les petites gens. Bientôt la société sera réinfectée de gens comme et faut ; la liberté des suffrages sera restreinte, les cabales seront plus faciles à nouer, plus difficiles à rompre, et, par le fait, entre deux classes séparées s’établira une sorte de hiérarchie. Ainsi l’ignorance de la langue compromettrait le bonheur social ou détruirait l’égalité.
Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner et leur obéir ; et telle était l’ignorance de quelques communes dans les premières époques de la Révolution que, confondant toutes les notions, associant des idées incohérentes et absurdes, elles s’étaient persuadé que le mot décret signifiait un décret de prise de corps ; qu’en conséquence devait intervenir un décret pour tuer tous les ci-devant privilégiés ; et l’on m’écrivait à ce sujet une anecdote qui serait plaisante, si elle n’était déplorable. Dans une commune les citoyens disaient : « Ce serait pourtant bien dur de tuer M. Geffry ; mais au moins il ne faudrait pas le faire souffrir. » Dans cette anecdote, à travers l’enveloppe de l’ignorance, on voit percer le sentiment naïf d’hommes qui d’avance calculent les moyens de concilier l’humanité avec l’obéissance.
Proposerez-vous de suppléer à cette ignorance par des traductions ? Alors vous multipliez les dépenses, en compliquant les rouages politiques, vous en ralentissez le mouvement : ajoutons que la majeure partie des dialectes vulgaires résistent à la traduction ou n’en promettent que d’infidèles. Si dans notre langue la partie politique est à peine créée, que peut-elle être dans des idiomes dont les uns abondent, à la vérité, en expressions sentimentales pour peindre les douces effusions du cœur, mais sont absolument dénués de termes relatifs à la politique ; les autres sont des jargons lourds et grossiers, sans syntaxe déterminée, parce que la langue est toujours la mesure du génie d’un peuple ; les mots ne croissent qu’avec la progression des idées et des besoins. Leibnitz avait raison. Les mots sont les lettres de change de l’entendement ; si donc il acquiert de nouvelles idées, il lui faut des termes nouveaux, sans quoi l’équilibre serait rompu. Plutôt que d’abandonner cette fabrication aux caprices de l’ignorance, il vaut mieux certainement lui donner votre langue ; d’ailleurs, l’homme des campagnes, peu accoutumé à généraliser ses idées, manquera toujours de termes abstraits ; et cette inévitable pauvreté de langage, qui resserre l’esprit, mutilera vos adresses et vos décrets, si même elle ne les rend intraduisibles.
Cette disparité de dialectes a souvent contrarié les opérations de vos commissaires dans les départements. Ceux qui se trouvaient aux Pyrénées-Orientales en octobre 1792 vous écrivirent que, chez les Basques, peuple doux et brave, un grand nombre était accessible au fanatisme, parce que l’idiome est un obstacle à la propagation des lumières. La même chose est arrivée dans d’autres départements, où des scélérats fondaient sur l’ignorance de notre langue le succès de leurs machinations contre-révolutionnaires.
C’est surtout vers nos frontières que les dialectes, communs aux peuples des limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses, tandis que, dans l’étendue de la République, tant de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales. Par l’influence respective des moeurs sur le langage, du langage sur les moeurs, ils empêchent l’amalgame politique, et d’un seul peuple en font trente. Cette observation acquiert un grand poids, si l’on considère que, faute de s’entendre, tant d’hommes se sont égorgés, et que souvent les querelles sanguinaires des nations, comme les querelles ridicules des scholastiques, n’ont été que de véritables logomachies. Il faut donc que l’unité de langue entre les enfants de la même famille éteigne les restes des préventions résultantes des anciennes divisions provinciales et resserre les liens d’amitié qui doivent unir des frères.
Des considérations d’un autre genre viennent à l’appui de nos raisonnements. Toutes les erreurs se tiennent comme toutes les vérités ; les préjugés les plus absurdes peuvent entraîner les conséquences les plus funestes. Dans quelques cantons ces préjugés sont affaiblis, mais dans la plupart des campagnes ils exercent encore leur empire. Un enfant ne tombe pas en convulsion, la contagion ne frappe pas une étable, sans faire naître l’idée qu’on a jeté un sort, c’est le terme. Si dans le voisinage il est quelque fripon connu sous le nom de devin, la crédulité va lui porter son argent, et des soupçons personnels font éclater des vengeances. Il suffirait de remonter à très-peu d’années pour trouver des assassinats commis sous prétexte de maléfice.
Les erreurs antiques ne font-elles donc que changer de formes en parcourant les siècles ? Que du temps de Virgile on ait supposé aux magiciennes de Thessalie la puissance d’obscurcir le soleil et de jeter la lune dans un puits, que dix-huit siècles après on ait cru pouvoir évoquer le diable, je ne vois là que des inepties diversement modifiées.
En veut-on un exemple plus frappant ? Le génie noir, chez les Celtes, plus noir que la poix, dit l’Edda ; l’éphiallès des Grecs, les lémures des Romains, le sotre vers Lunéville, le drac dans le ci-devant Languedoc, le chaouce-bieille dans quelques coins de la ci-devant Gascogne, sont, depuis quarante siècles, le texte de mille contes puérils, pour expliquer ce que les médecins nomment le cochemar.
Les Romains croyaient qu’il était dangereux de se marier au mois de mai ; cette idée s’est perpétuée chez les Juifs ; Astruc l’a retrouvée dans le ci-devant Languedoc.
Actuellement encore les cultivateurs, pour la plupart, sont infatués de toutes les idées superstitieuses que des auteurs anciens, estimables d’ailleurs, comme Aristote, Élien, Pline et Columelle, ont consignées dans leurs écrits : tel est un prétendu secret pour faire périr les insectes, qui des Grecs est passé aux Romains et que nos faiseurs de maisons rustiques ont tant répété. C’est surtout l’ignorance de l’idiome national qui tient tant d’individus à une grande distance de la vérité : cependant, si vous ne les mettez en communication directe avec les hommes et les livres, leurs erreurs, accumulées, enracinées depuis des siècles, seront indestructibles.
Pour perfectionner l’agriculture et toutes les branches de l’économie rurale, si arriérées chez nous, la connaissance de la langue nationale est également indispensable. Rozier observe que, d’un village à l’autre, les cultivateurs ne s’entendent pas ; après cela, dit-il, comment les auteurs qui traitent de la vigne prétendent-ils qu’on les entendra ? Pour fortifier son observation, j’ajoute que, dans quelques contrées méridionales de la France, le même cep de vigne a trente noms différents. Il en est de même de l’art nautique, de l’extraction des minéraux, des instruments ruraux, des maladies, des grains, et spécialement des plantes. Sur ce dernier article, la nomenclature varie non seulement dans des localités très-voisines, mais encore dans des époques très-rapprochées. Le botaniste Villars, qui en donne plusieurs preuves, cite Sollier, qui, plus que personne, ayant fait des recherches, dans les villages, sur les dénominations vulgaires des végétaux, n’en a trouvé qu’une centaine bien nommés. Il en résulte que les livres les plus usuels sont souvent inintelligibles pour les citoyens des campagnes.
Il faut donc, en révolutionnant les arts, uniformer leur idiome technique ; il faut que les connaissances disséminées éclairent toute la surface du territoire français, semblables à ces réverbères qui, sagement distribués dans toutes les parties d’une cité, y répartissent la lumière. Un poëte a dit:
Peut-être qu’un Lycurgue, un Cicéron sauvage,
Est chantre de paroisse ou maire de village.
Les développements du génie attesteront cette vérité et prouveront que, surtout, parmi les hommes de la nature se trouvent les grands hommes.
Les relations des voyageurs étrangers insistent sur le désagrément qu’ils éprouvaient de ne pouvoir recueillir des renseignements dans les parties de la France où le peuple ne parle pas français. Ils nous comparent malignement aux Islandais, qui, au milieu des frimas d’une région sauvage, connaissent tous l’histoire de leur pays, afin de nous donner le désavantage du parallèle. Un Anglais, dans un écrit qui décèle souvent la jalousie, s’égaie sur le compte d’un marchand qui lui demandait si, en Angleterre, il y avait des arbres et des rivières, et à qui il persuada que, d’ici à la Chine, il y avait environ 200 lieues. Les Français, si redoutables aux Anglais par leurs baïonnettes, doivent leur prouver encore qu’ils ont sur eux la supériorité du génie, comme celle de la loyauté : il leur suffit de vouloir.
Quelques objections m’ont été faites sur l’utilité du plan que je propose. Je vais les discuter.
Penserez-vous, m’a-t-on dit, que les Français méridionaux se résoudront facilement à quitter un langage qu’ils chérissent par habitude et par sentiment ? Leurs dialectes, appropriés au génie d’un peuple qui pense vivement et s’exprime de même, ont une syntaxe où l’on rencontre moins d’anomalie que dans notre langue. Par leurs richesses et leurs prosodies éclatantes, ils rivalisent avec la douceur de l’italien et la gravité de l’espagnol ; et probablement, au lieu de la langue des trouvères, nous parlerions celle des troubadours, si Paris, le centre du Gouvernement, avait été situé sur la rive gauche de la Loire.
Ceux qui nous font cette objection ne prétendent pas sans doute que d’Astros et Goudouli soutiendront le parallèle avec Pascal, Fénelon et Jean-Jacques. L’Europe a prononcé sur cette langue, qui, tour à tour embellie par la main des grâces, insinue dans les coeurs les charmes de la vertu, ou qui, faisant retentir les accents fiers de la liberté, porte l’effroi dans le repaire des tyrans. Ne faisons point à nos frères du Midi l’injure de penser qu’ils repousseront une idée utile à la patrie. Ils ont abjuré et combattu le fédéralisme politique ; ils combattront avec la même énergie celui des idiomes. Notre langue et nos coeurs doivent être à l’unisson.
Cependant la connaissance des dialectes peut jeter du jour sur quelques monuments du moyen âge. L’histoire et les langues se prêtent un secours mutuel pour juger les habitudes ou le génie d’un peuple vertueux ou corrompu, commerçant, navigateur ou agricole. La filiation des termes conduit à celle des idées ; par la comparaison des mots radicaux, des usages, des formules philosophiques ou proverbes, qui sont les fruits de l’expérience, on remonte à l’origine des nations.
L’histoire étymologique des langues, dit le célèbre Sulzer, serait la meilleure histoire des progrès de l’esprit humain. Les recherches de Peloutier, Bochart, Gebelin, Bochat, Lebrigand, etc., ont déjà révélé des faits assez étonnants pour éveiller la curiosité et se promettre de grands résultats. Les rapports de l’allemand au persan, du suédois à l’hébreu, de la langue basque à celle du Malabar, de celle-ci à celle des Bohémiens errants, de celle du pays de Vaud à l’irlandais, la presque identité de l’irlandais, qui a l’alphabet de Cadmus, composé de dix-sept lettres, avec le punique; son analogie avec l’ancien celtique, qui, conservé traditionnellement dans le nord de l’Écosse, nous a transmis les chefs-d’œuvre d’Ossian ; les rapports démontrés entre les langues de l’ancien et du Nouveau Monde, en établissant l’affinité des peuples par celle des idiomes, prouveront d’une manière irréfragable l’unité de la famille humaine et de son langage, et, par la réunion d’un petit nombre d’éléments connus, rapprocheront les langues, en faciliteront l’étude et en diminueront le nombre.
Ainsi la philosophie, qui promène son flambeau dans toute la sphère des connaissances humaines, ne croira pas indigne d’elle de descendre à l’examen des patois, et, dans ce moment favorable pour révolutionner notre langue, elle leur dérobera peut-être des expressions enflammées, des tours naïfs qui nous manquent. Elle puisera surtout dans le provençal, qui est encore rempli d’hellénismes, et que les Anglais même, mais surtout les Italiens, ont mis si souvent à contribution.
Presque tous les idiomes ont des ouvrages qui jouissent d’une certaine réputation. Déjà la Commission des arts, dans son instruction, a recommandé de recueillir ces monuments imprimés ou manuscrits ; il faut chercher des perles jusque dans le fumier d’Ennius.
Une objection, plus grave en apparence, contre la destruction des dialectes rustiques, est la crainte de voir les mœurs s’altérer dans les campagnes. On cite spécialement le Haut-Pont, qui, à la porte de Saint-Omer, présente une colonie laborieuse de trois mille individus, distingués par leurs habits courts à la manière des Gaulois, par leurs usages, leur idiome, et surtout par cette probité patriarcale et cette simplicité du premier âge.
Comme rien ne peut compenser la perte des mœurs, il n’y a pas à balancer pour le choix entre le vice éclairé et l’innocence vertueuse. L’objection eût été insoluble sous le règne du despotisme. Dans une monarchie, le scandale des palais insulte à la misère des cabanes, et, comme il y a des gens qui ont trop, nécessairement d’autres ont trop peu. Le luxe et l’orgueil de tyranneaux, prêtres, nobles, financiers et autres, enlevaient une foule d’individus à l’agriculture et aux arts.
De là cette multitude de femmes de chambre, de valets de chambre, de laquais, qui reportaient ensuite dans leurs hameaux des manières moins gauches, un langage moins rustre, mais une dépravation contagieuse qui gangrenait les villages. De tous les individus qui, après avoir habité les villes, retournaient sous le toit paternel, il n’y avait guère de bons que les vieux soldats.
Le régime républicain a opéré la suppression de toutes les castes parasites, le rapprochement des fortunes, le nivellement des conditions. Dans la crainte d’une dégénération morale, des familles nombreuses, d’estimables campagnards, avaient pour maxime de n’épouser que dans leur parenté. Cet isolement n’aura plus lieu, parce qu’il n’y a plus en France qu’une seule famille. Ainsi la forme nouvelle de notre gouvernement et l’austérité de nos principes repoussent toute parité entre l’ancien et le nouvel état de choses. La population refluera dans les campagnes, et les grandes communes ne seront plus des foyers putrides d’où sans cesse la fainéantise et l’opulence exhalaient le crime. C’est là surtout que les ressorts moraux doivent avoir plus d’élasticité. Des moeurs ! sans elles point de République, et sans République point de moeurs.
Tout ce qu’on vient de dire appelle la conclusion, que pour extirper tous les préjugés, développer toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, fondre tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le méchanisme et faciliter le jeu de la machine politique, il faut identité de langage. Le temps amènera sans doute d’autres réformes nécessaires dans le costume, les manières et les usages. Je ne citerai que celui d’ôter le chapeau pour saluer, qui devrait être remplacé par une forme moins gênante et plus expressive.
En avouant l’utilité d’anéantir les patois, quelques personnes en contestent la possibilité ; elles se fondent sur la ténacité du peuple dans ses usages. On m’allègue les Morlaques, qui ne mangeaient pas de veau il y a quatorze siècles et qui sont restés fidèles à cette abstinence ; les Grecs, chez qui, selon Guys, se conserve avec éclat la danse décrite, il y a trois mille ans, par Homère dans son bouclier d’Achille.
On cite Tournefort, au rapport duquel les Juifs de Pruse en Natolie, descendants de ceux qui depuis longtemps avaient été chassés d’Espagne, parlaient espagnol comme à Madrid. On cite les protestants réfugiés à la révocation de l’édit de Nantes, dont la postérité a tellement conservé l’idiome local, que, dans la Hesse et le Brandebourg, on retrouve les patois gascon et picard.
Je crois avoir établi que l’unité de l’idiome est une partie intégrante de la révolution, et, dès lors plus on m’opposera de difficultés, plus on me prouvera la nécessité d’opposer des moyens pour les combattre. Dût-on n’obtenir qu’un demi-succès, mieux vaudrait encore faire un peu de bien que de n’en point faire. Mais répondre par des faits, c’est répondre péremptoirement, et tous ceux qui ont médité sur la manière dont les langues naissent, vieillissent et meurent, regarderont la réussite comme infaillible.
Il y a un siècle qu’à Dieuse un homme fut exclus d’une place publique parce qu’il ignorait l’allemand, et cette langue est déjà repoussée à grande distance au delà de cette commune. Il y a cinquante ans que, dans sa Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, Papillon disait, en parlant des noëls de la Monnoie : « Ils conserveront le souvenir d’un idiome qui commence à se perdre comme la plupart des autres patois de la France. » Papon a remarqué la même chose dans la ci-devant Provence. L’usage de prêcher en patois s’était conservé dans quelques contrées. Mais cet usage diminuait sensiblement ; il s’était même éteint dans quelques communes, comme à Limoges. Il y a une vingtaine d’années qu’à Périgueux il était encore honteux de francimander, c’est-à-dire de parler français. L’opinion a tellement changé, que bientôt, sans doute, il sera honteux de s’énoncer autrement. Partout, ces dialectes se dégrossissent, se rapprochent de la langue nationale ; cette vérité résulte des renseignements que m’ont adressés beaucoup de sociétés populaires.
Déjà la révolution a fait passer un certain nombre de mots français dans tous les départements, où ils sont presque universellement connus, et la nouvelle distribution du territoire a établi de nouveaux rapports qui contribuent à propager la langue nationale.
La suppression de la dîme, de la féodalité, du droit coutumier, l’établissement du nouveau système des poids et mesures, entraînent l’anéantissement d’une multitude de termes qui n’étaient que d’un usage local.
Le style gothique de la chicane a presque entièrement disparu, et sans doute le Code civil en secouera les derniers lambeaux.
En général, dans nos bataillons on parle français, et cette masse de républicains qui en aura contracté l’usage le répandra dans ses foyers. Par l’effet de la révolution, beaucoup de ci-devant citadins iront cultiver leurs terres. Il y aura plus d’aisance dans les campagnes ; on ouvrira des canaux et des routes ; on prendra, pour la première fois, des mesures efficaces pour améliorer les chemins vicinaux ; les fêtes nationales, en continuant à détruire les tripots, les jeux de hasard, qui ont désolé tant de familles, donneront au peuple des plaisirs dignes de lui : l’action combinée de ces opérations diverses doit tourner au profit de la langue française.
Quelques moyens moraux, et qui ne sont pas l’objet d’une loi, peuvent encore accélérer la destruction des patois.
Le 14 janvier 1790, l’Assemblée constituante ordonna de traduire ses décrets en dialectes vulgaires. Le tyran n’eut garde de faire une chose qu’il croyait utile à la liberté. Au commencement de sa session, la Convention nationale s’occupa du même objet. Cependant j’observerai que, si cette traduction est utile, il est un terme où cette mesure doit cesser, car ce serait prolonger l’existence des dialectes que nous voulons proscrire, et, s’il faut encore en faire usage, que ce soit pour exhorter le peuple à les abandonner.
Associez à vos travaux ce petit nombre d’écrivains qui rehaussent leurs talents par leur républicanisme. Répandez avec profusion, dans les campagnes surtout, non de gros livres (communément ils épouvantent le goût et la raison), mais une foule d’opuscules patriotiques, qui contiendront des notions simples et lumineuses, que puisse saisir l’homme à conception lente et dont les idées sont obtuses ; qu’il y ait de ces opuscules sur tous les objets relatifs à la politique et aux arts, dont j’ai déjà observé qu’il fallait uniformer la nomenclature. C’est la partie la plus négligée de notre langue : car, malgré les réclamations de Leibnitz, la ci-devant Académie française, à l’imitation de celle della Crusca, ne jugea pas à propos d’embrasser cet objet dans la confection de son dictionnaire, qui en a toujours fait désirer un autre.
Je voudrais des opuscules sur la météorologie, qui est d’une application immédiate à l’agriculture. Elle est d’autant plus nécessaire, que jusqu’ici le campagnard, gouverné par les sottises astrologiques, n’ose encore faucher son pré sans la permission de l’almanach.
J’en voudrais même sur la physique élémentaire. Ce moyen est propre à flétrir une foule de préjugés ; et, puisque inévitablement l’homme des campagnes se formera une idée sur la configuration de la terre, pourquoi, dit quelqu’un, ne pas lui donner la véritable ? Répétons-le : toutes les erreurs se donnent la main, comme toutes les vérités.
De bons journaux sont une mesure d’autant plus efficace, que chacun les lit ; et l’on voit avec intérêt les marchandes à la halle, les ouvriers dans les ateliers, se cotiser pour les acheter, et de concert faire la tâche de celui qui lit.
Les journalistes (qui devraient donner plus à la partie morale) exercent une sorte de magistrature d’opinion propre à seconder nos vues, en les reproduisant sous les yeux des lecteurs : leur zèle à cet égard nous donnera la mesure de leur patriotisme.
Parmi les formes variées des ouvrages que nous proposons, celle du dialogue peut être avantageusement employée. On sait combien elle a contribué au succès des Magasins des enfants, des adolescents, etc.
Surtout qu’on n’oublie pas d’y mêler de l’historique. Les anecdotes sont le véhicule du principe, et sans cela il s’échappera. L’importance de cette observation sera sentie par tous ceux qui connaissent le régime des campagnes. Outre l’avantage de fixer les idées dans l’esprit d’un homme peu cultivé, par là, vous mettez en jeu son amour-propre en lui donnant un moyen d’alimenter la conversation ; sinon quelque plat orateur s’en empare, pour répéter tous les contes puérils de la bibliothèque bleue, des commères et du sabat, et l’on ose d’autant moins le contredire, que c’est presque toujours un vieillard qui assure avoir ouï, vu et touché.
Le fruit des lectures utiles en donnera le goût, et bientôt seront vouées au mépris ces brochures souillées de lubricité ou d’imprécations convulsives qui exaltent les passions au lieu d’éclairer la raison ; et même ces ouvrages prétendus moraux dont actuellement on nous inonde, qui sont inspirés par l’amour du bien, mais à la rédaction desquels n’ont présidé ni le goût, ni la philosophie.
Au risque d’essuyer des sarcasmes, dont il vaut mieux être l’objet que l’auteur, ne craignons pas de dire que les chansons, les poésies lyriques importent également à la propagation de la langue et du patriotisme : ce moyen est d’autant plus efficace, que la construction symétrique des vers favorise la mémoire ; elle y place le mot et la chose.
Il était bien pénétré de cette vérité ce peuple harmonieux, pour ainsi dire, chez qui la musique était un ressort entre les mains de la politique. Chrysippe ne crut pas se ravaler en faisant des chansons pour les nourrices. Platon leur ordonne d’en enseigner aux enfants. La Grèce en avait pour toutes les grandes époques de la vie et des saisons, pour la naissance, les noces, les funérailles, la moisson, les vendanges ; surtout elle en avait pour célébrer la liberté. La chanson d’Harmodius et d’Aristogiton, qu’Athénée nous a conservée, était chez eux ce qu’est parmi nous l’air des Marseillais ; et pourquoi le Comité d’instruction publique ne ferait-il pas, dans ce genre, un triage avoué par le goût et le patriotisme ?
Des chansons historiques et instructives, qui ont la marche sentimentale de la romance, ont pour les citoyens des campagnes un charme particulier. N’est-ce pas là l’unique mérite de cette strophe mal agencée, qui fait fondre en larmes les nègres de l’île de Saint-Vincent ? C’est une romance qui faisait pleurer les bons Morlaques, quoique le voyageur Fortis, avec une âme sensible, n’en fût pas affecté. C’est là ce qui fit le succès de Geneviève de Brabant, et qui assurera celui d’une pièce attendrissante de Berquin. Avez-vous entendu les échos de la Suisse répéter, dans les montagnes, les airs dans lesquels Lavater célèbre les fondateurs de la liberté helvétique ? Voyez si l’enthousiasme qu’inspirent ces chants républicains n’est pas bien supérieur aux tons langoureux des barcaroles de Venise, lorsqu’ils répètent les octaves galantes du Tasse.
Substituons donc des couplets riants et décents à ces stances impures ou ridicules, dont un vrai citoyen doit craindre de souiller sa bouche ; que, sous le chaume et dans les champs, les paisibles agriculteurs adoucissent leurs travaux en faisant retentir les accents de la joie, de la vertu et du patriotisme. La carrière est ouverte aux talents ; espérons que les poëtes nous feront oublier les torts des gens de lettres dans la révolution.
Ceci conduit naturellement à parler des spectacles. La probité, la vertu, sont à l’ordre du jour, et cet ordre du jour doit être éternel. Le théâtre ne s’en doute pas, puisqu’on y voit encore, dit-on, tour à tour préconiser les moeurs et les insulter : il y a peu qu’on a donné le Cocher supposé, par Hauteroche. Poursuivons l’immoralité sur la scène, de plus, chassons-en le jargon, par lequel on établit encore entre les citoyens égaux une sorte de démarcation. Sous un despote, Dufresny, Dancourt, etc., pouvaient impunément amener sur le théâtre des acteurs qui, en parlant un demi patois, excitaient le rire ou la pitié : toutes les convenances doivent actuellement proscrire ce ton. Vainement m’objecterez-vous que Plaute introduit dans ses pièces des hommes qui articulaient le latin barbare des campagnes d’Ausonie ; que les Italiens, et récemment encore Goldoni, produisent sur la scène leur marchand vénitien, et le patois bergamasque de Brighella, etc. Ce qu’on nous cite pour un exemple à imiter n’est qu’un abus à réformer.
Je voudrais que toutes les municipalités admissent dans leurs discussions l’usage exclusif de la langue nationale ; je voudrais qu’une police sage fît rectifier cette foule d’enseignes qui outragent la grammaire et fournissent aux étrangers l’occasion d’aiguiser l’épigramme ; je voudrais qu’un plan systématique répudiât les dénominations absurdes des places, rues, quais et autres lieux publics. J’ai présenté des vues à cet égard.
Quelques sociétés populaires du Midi discutent en provençal : la nécessité d’universaliser notre idiome leur fournit une nouvelle occasion de bien mériter de la patrie. Eh ! pourquoi la Convention nationale ne ferait-elle pas aux citoyens l’invitation civique de renoncer à ces dialectes et de s’énoncer constamment en français ?
La plupart des législateurs anciens et modernes ont eu le tort de ne considérer le mariage que sous le point de vue de la reproduction de l’espèce. Après avoir fait la première faute de confondre la nubilité avec la puberté, qui ne sont des époques identiques que chez l’homme de la nature, oublierons-nous que, lorsque les individus veulent s’épouser, ils doivent garantir à la patrie qu’ils ont les qualités morales pour remplir tous les devoirs de citoyens, tous les devoirs de la paternité ? Dans certains cantons de la Suisse, celui qui veut se marier doit préalablement justifier qu’il a son habit militaire, son fusil et son sabre. En consacrant chez nous cet usage, pourquoi les futurs époux ne seraient-ils pas soumis à prouver qu’ils savent lire, écrire et parler la langue nationale ? Je conçois qu’il est facile de ridiculiser ces vues : il est moins facile de démontrer qu’elles sont déraisonnables. Pour jouir du droit de cité, les Romains n’étaient-ils pas obligés de faire preuve qu’ils savaient lire et nager ?
Encourageons tout ce qui peut être avantageux à la patrie ; que dès ce moment l’idiome de la liberté soit à l’ordre du jour, et que le zèle des citoyens proscrive à jamais les jargons, qui sont les derniers vestiges de la féodalité détruite. Celui qui, connaissant à demi notre langue, ne la parlait que quand il était ivre ou en colère, sentira qu’on peut en concilier l’habitude avec celle de la sobriété et de la douceur. Quelques locutions bâtardes, quelques idiotismes, prolongeront encore leur existence dans le canton où ils étaient connus. Malgré les efforts de Desgrouais, les Gasconismes corrigés sont encore à corriger. Les citoyens de Saintes iront encore voir leur borderie ; ceux de Blois, leur closerie, et ceux de Paris, leur métairie. Vers Bordeaux, on défrichera des landes ; vers Nimes, des garrigues. Mais enfin les vraies dénominations prévaudront même parmi les ci-devant Basques et Bretons, à qui le gouvernement aura prodigué ses moyens, et, sans pouvoir assigner l’époque fixe à laquelle ces idiomes auront entièrement disparu, on peut augurer qu’elle est prochaine.
Les accents feront une plus longue résistance, et probablement les peuples voisins des Pyrénées changeront encore, pendant quelque temps, les e muets en é fermés, le b en v, les f en h. A la Convention nationale, on retrouve les inflexions et les accents de toute la France. Les finales traînantes des uns, les consonnes gutturales ou nasales des autres, ou même des nuances presque imperceptibles, décèlent presque toujours le département de celui qui parle.
L’organisation, nous dit-on, y, contribue. Quelques peuples ont une inflexibilité d’organe qui se refuse à l’articulation de certaines lettres ; tels sont les Chinois, qui ne peuvent prononcer la dentale r ; les Hurons qui, au rapport de La Hontan, n’ont pas de labiale, etc. Cependant si la prononciation est communément plus douce dans les plaines, plus fortement accentuée dans les montagnes ; si la langue est plus paresseuse dans le Nord et plus souple dans le Midi ; si, généralement parlant, les Vitriats et les Marseillais grasseyent, quoique situés à des latitudes un peu différentes, c’est plutôt à l’habitude qu’à la nature qu’il faut en demander la raison ; ainsi n’exagérons pas l’influence du climat. Telle langue est articulée de la même manière dans des contrées très-distantes, tandis que dans le même pays la même langue est diversement prononcée. L’accent n’est donc pas plus irréformable que les mots.
Je finirai ce discours en présentant l’esquisse d’un projet vaste et dont l’exécution est digne de vous : c’est celui de révolutionner notre langue.
J’explique ma pensée :
Les mots étant les liens de la société et les dépositaires de toutes nos connaissances, il s’ensuit que l’imperfection des langues est une grande source d’erreurs. Condillac voulait qu’on ne pût faire un raisonnement faux sans faire un solécisme, et réciproquement : c’est peut-être exiger trop. Il serait impossible de ramener une langue au plan de la nature et de l’affranchir entièrement des caprices de l’usage. Le sort de toutes les langues est d’éprouver des modifications ; il n’est pas jusqu’aux lingères qui n’aient influé sur la nôtre, et supprimé l’aspiration de l’h dans les toiles d’Hollande. Quand un peuple s’instruit, nécessairement sa langue s’enrichit, parce que l’augmentation des connaissances établit des alliances nouvelles entre les paroles et les pensées et nécessite des termes nouveaux. Vouloir condamner une langue à l’invariabilité sous ce rapport, ce serait condamner le génie national à devenir stationnaire ; et si, comme on l’a remarqué depuis Homère jusqu’à Plutarque, c’est-à-dire pendant mille ans, la langue grecque n’a pas changé, c’est que le peuple qui la parlait a fait très-peu de progrès durant ce laps de siècles.
Mais ne pourrait-on pas au moins donner un caractère plus prononcé, une consistance plus décidée à notre syntaxe, à notre prosodie ; faire à notre idiome les améliorations dont il est susceptible, et, sans en altérer le fonds, l’enrichir, le simplifier, en faciliter l’étude aux nationaux et aux autres peuples. Perfectionner une langue, dit Michaelis, c’est augmenter le fonds de sagesse d’une nation.
Sylvius, Duclos et quelques autres, ont fait d’inutiles efforts pour assujétir la langue écrite à la langue parlée ; et ceux qui proposent encore aujourd’hui d’écrire comme on prononce seraient bien embarrassés d’expliquer leur pensée, d’en faire l’application, puisque les rapports de l’écriture à la parole étant purement conventionnels, la connaissance de l’une ne donnera jamais celle de l’autre ; toutefois il est possible d’opérer sur l’orthographe des rectifications utiles.
2° Quiconque a lu Vaugelas, Bouhours, Ménage, Hardouin, Olivet et quelques autres, a pu se convaincre que notre langue est remplie d’équivoques et d’incertitudes ; il serait également utile et facile de les fixer.
3° La physique et l’art social, en se perfectionnant, perfectionnent la langue ; il est une foule d’expressions qui par là ont acquis récemment une acception accessoire ou même entièrement différente. Le terme souverain est enfin fixé à son véritable sens, et je maintiens qu’il serait utile de faire une revue générale des mots pour donner de la justesse aux définitions. Une nouvelle grammaire et un nouveau dictionnaire ne paraissent aux hommes vulgaires qu’un objet de littérature. L’homme qui voit à grande distance placera cette mesure dans ses conceptions politiques. Il faut qu on ne puisse apprendre notre langue sans pomper nos principes.
4° La richesse d’un idiome n’est pas d’avoir des synonymes ; s’il y en avait dans notre langue, ce seraient sans doute monarchie et crime, ce seraient république et vertu. Qu’importe que l’Arabe ait trois cents mots pour exprimer un serpent ou un cheval ! La véritable abondance consiste à exprimer toutes les pensées, tous les sentiments et leurs nuances. Jamais, sans doute le nombre des expressions n’atteindra celui des affections et des idées : c’est un malheur inévitable auquel sont condamnées toutes les langues ; cependant on peut atténuer cette privation.
5° La plupart des idiomes, même ceux du Nord, y compris le russe, qui est le fils de l’esclavon, ont beaucoup d’imitatifs, d’augmentatifs, de diminutifs et de péjoratifs. Notre langue est une des plus indigentes à cet égard ; son génie paraît y répugner. Cependant, sans encourir le ridicule qu’on répandit, avec raison, sur le boursouflage scientifique de Baïf, Ronsard et Jodelet, on peut se promettre quelques heureuses acquisitions ; déjà Pougens a fait une ample moisson de privatifs, dont la majeure partie sera probablement admise.
Dans le dictionnaire de Nicod, imprimé en 1606, sous le Z il n’y avait que six mots ; dans celui de la ci-devant Académie française, édition de 1718, il y en avait douze ; sous la syllabe Be, Nicod n’avait que 45 termes ; celui de l’Académie, même édition, en avait 217 : preuve évidente que dans cet intervalle l’esprit humain a fait des progrès, puisque ce sont les inventions nouvelles qui déterminent la création des mots ; et cependant Barbasan, La Ravalière et tous ceux qui ont suivi les révolutions de la langue française, déplorent la perte de beaucoup d’expressions énergiques et d’inversions hardies exilées par le caprice, qui n’ont pas été remplacées et qu’il serait important de faire revivre.
Pour compléter nos familles de mots, il est encore d’autres moyens : le premier serait d’emprunter des idiomes étrangers les termes qui nous manquent et de les adapter au nôtre, sans toutefois se livrer aux excès d’un néologisme ridicule. Les Anglais ont usé de la plus grande liberté à cet égard, et de tous les mots qu’ils ont adoptés, il n’en est pas sans doute de mieux naturalisé chez eux que celui de perfidiousness.
Le second moyen, c’est de faire disparaître toutes les anomalies résultantes soit des verbes réguliers et défectifs, soit des exceptions aux règles générales. A l’institution des sourds-muets, les enfants qui apprennent la langue française ne peuvent concevoir cette bizarrerie, qui contredit la marche de la nature dont ils sont les élèves ; et c’est sous sa dictée qu’ils donnent à chaque mot décliné, conjugué ou construit, toutes les modifications qui, suivant l’analogie des choses, doivent en dériver.
« Il y a dans notre langue, disait un royaliste, une hiérarchie de style, parce que les mots sont classés comme les sujets dans une monarchie. »
Cet aveu est un trait de lumière pour quiconque réfléchit. En appliquant l’inégalité des styles à celle des conditions, on peut tirer des conséquences qui prouvent l’importance de mon projet dans une démocratie.
Celui qui n’aurait pas senti cette vérité, serait-il digne d’être législateur d’un peuple libre ? Oui, la gloire de la nation et le maintien de ses principes commandent une réforme.
On disait de Quinault qu’il avait désossé notre langue par tout ce que la galanterie a de plus efféminé et tout ce que l’adulation a de plus abject. J’ai déjà fait observer que la langue française avait la timidité de l’esclavage quand la corruption des courtisans lui imposait des lois : c’était le jargon des coteries et des passions les plus viles. L’exagération du discours plaçait toujours au delà ou en deçà la vérité. Au lieu d’être peinés ou réjouis, on ne voyait que des gens désespérés ou enchantés ; bientôt il ne serait plus resté rien de laid ni de beau dans la nature : on n’aurait trouvé que de l’exécrable ou du divin.
Il est temps que le style mensonger, que les formules serviles disparaissent, et que la langue ait partout ce caractère de véracité et de fierté laconique qui est l’apanage des républicains. Un tyran de Rome voulut autrefois introduire un mot nouveau ; il échoua, parce que la législation des langues fut toujours démocratique. C’est précisément cette vérité qui vous garantit le succès. Prouvez à l’univers qu’au milieu des orages politiques, tenant d’une main sûre le gouvernail de l’État, rien de ce qui intéresse la gloire de la nation ne vous est étranger.
Si la Convention nationale accueille les vues que je lui soumets au nom du Comité d’instruction publique, encouragés par son suffrage, nous ferons une invitation aux citoyens qui ont approfondi la théorie des langues pour concourir à perfectionner la nôtre et une invitation à tous les citoyens pour universaliser son usage. La nation, entièrement rajeunie par vos soins, triomphera de tous les obstacles et rien ne ralentira le cours d’une révolution qui doit améliorer le sort de l’espèce humaine.
|
|
